Trouble du comportement pendant le sommeil REM : Médicaments et évaluation neurologique
 nov., 23 2025
nov., 23 2025
Qu’est-ce que le trouble du comportement pendant le sommeil REM ?
Le trouble du comportement pendant le sommeil REM (RBD) est une parasomnie rare mais sérieuse. Pendant la phase normale du sommeil REM - celle où les rêves les plus vifs se produisent - notre corps entre en paralysie musculaire pour éviter que nous n’agissions nos rêves. Chez les personnes atteintes de RBD, cette paralysie disparaît. Résultat : elles bougent, crient, frappent, sautent du lit, ou même se lèvent et marchent, tout en étant profondément endormies. Ces comportements ne sont pas intentionnels. Ils sont une réaction physique à des rêves violents ou intensément émotionnels, souvent liés à une fuite, une lutte ou une attaque.
Les conséquences peuvent être graves. Des fractures, des contusions, des coupures, ou des blessures au visage sont fréquentes. Les partenaires de lit sont souvent les premières victimes. Une étude de 2019 a montré que 78 % des patients avec RBD ont dû modifier leur chambre pour éviter les blessures : retirer les objets tranchants, rembourrer les coins des meubles, poser des tapis au sol. Dans 42 % des cas, les couples finissent par dormir séparément, même sous traitement.
Comment est-diagnostiqué le RBD ?
Le diagnostic ne repose pas sur un simple récit. Il exige une étude du sommeil en laboratoire, appelée polysomnographie (PSG). Cette épreuve enregistre l’activité cérébrale, les mouvements oculaires, la respiration, et surtout, le tonus musculaire pendant le sommeil REM. La signature clé du RBD est l’absence d’atonie musculaire - c’est-à-dire une activité électrique anormalement élevée dans les muscles du corps pendant la phase REM.
Les critères internationaux (ICSD-3) exigent que cette activité musculaire dépasse 15 % des époques de sommeil REM. En moyenne, les patients présentent environ 4,2 épisodes de comportements complexes par heure de sommeil. Sans PSG, le RBD est souvent confondu avec des cauchemars normaux, des crises d’épilepsie nocturne, ou même un trouble du comportement lié à l’alcool.
Le diagnostic n’est pas seulement une question de sommeil. Il est aussi un signal d’alerte neurologique. Environ 90 % des cas de RBD sont liés à des maladies neurodégénératives futures : maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy, ou atrophie systémique multiple. Une étude de 2010 a montré que 73,5 % des patients avec un RBD idiopathique développent l’une de ces maladies dans les 12 ans suivants. C’est pourquoi tout diagnostic de RBD doit être suivi d’un suivi neurologique annuel.
Les traitements médicamenteux : les deux piliers
Il n’existe aucun médicament approuvé spécifiquement pour le RBD par la FDA ou l’EMA. Mais deux substances sont devenues des références, malgré leur utilisation en dehors de leur indication initiale.
Mélatonine : la voie douce
La mélatonine, hormone naturelle régulant le sommeil, est devenue la première ligne de traitement pour de nombreux neurologues. Elle agit en rétablissant partiellement la paralysie musculaire pendant le REM. Les doses commencent à 3 mg, prises 30 minutes avant le coucher. Si les résultats sont insuffisants, la dose est augmentée par paliers de 3 mg toutes les deux à quatre semaines, jusqu’à 12 mg.
Environ 65 % des patients voient une réduction significative de leurs épisodes. Un cas rapporté à la Cleveland Clinic montre un homme de 68 ans qui est passé de 7 épisodes par semaine à 1 après 6 mg de mélatonine. Les effets secondaires sont rares : maux de tête légers, somnolence matinale (souvent passagère). Sa sécurité en vieillissement en fait un choix idéal pour les personnes âgées.
Clonazépam : l’efficacité à haut risque
Le clonazépam, un benzodiazépine, est plus puissant. Il agit sur les récepteurs GABA du cerveau pour réduire l’activité motrice. La dose initiale est de 0,25 à 0,5 mg avant le coucher. Elle peut être augmentée jusqu’à 2 mg, selon la réponse.
Il est efficace chez 80 à 90 % des patients. Un partenaire a décrit : « Après que mon mari a commencé 0,5 mg de clonazépam, j’ai pu enfin dormir dans le même lit sans avoir peur d’être frappé. »
Mais les risques sont réels. Chez les personnes âgées, il augmente le risque de chutes de 34 %, cause des étourdissements chez 22 % des patients, et de somnolence diurne chez 15 %. Il peut aussi provoquer une dépendance. Une interruption brutale entraîne des cauchemars intenses chez 38 % des patients. Son utilisation exige une surveillance étroite et une réduction progressive : on diminue de 0,125 mg toutes les 1 à 2 semaines.

Les alternatives émergentes
De nouvelles pistes se dessinent. Les antagonistes des récepteurs de l’oréxine - une classe de médicaments initialement conçus pour traiter l’insomnie - montrent un potentiel prometteur. Des recherches de l’hôpital Mount Sinai (octobre 2023) ont montré que des substances comme le suvorexant réduisent de 78 % les comportements de rêve dans des modèles animaux. Le médicament NBI-1117568, développé par Neurocrine Biosciences, a reçu une désignation « Fast Track » de la FDA en janvier 2023. Des essais cliniques sont en cours, avec des résultats attendus en 2024.
Le pramipexole, un agoniste de la dopamine utilisé pour la maladie de Parkinson, est parfois prescrit, surtout si le patient a aussi un syndrome des jambes sans repos. Mais son efficacité est plus variable : seulement 60 % des patients répondent. Le rivastigmine, un inhibiteur de la cholinestérase utilisé en démence, a montré des résultats positifs dans des cas résistants, mais il n’est pas recommandé en première intention.
Les mesures de sécurité : plus qu’un traitement
Les médicaments ne suffisent pas. La sécurité du lit est une priorité absolue. Voici ce que recommandent les cliniques spécialisées :
- Retirer toutes les armes, couteaux ou objets tranchants de la chambre.
- Rembourrer les coins des meubles, des tables, des chaises.
- Poser des tapis ou des matelas au sol, surtout près du lit.
- Installer des barrières de lit si les épisodes sont fréquents ou violents.
- Éviter l’alcool à tout prix : même 1 à 2 verres peuvent déclencher un épisode chez 65 % des patients.
- Ne pas dormir dans un lit à eau ou un lit haut sans protection.
Ces modifications ne sont pas une concession. Elles sont vitales. Une étude de 2019 a montré que 78 % des patients les ont mises en œuvre - et 92 % ont signalé une réduction des blessures.
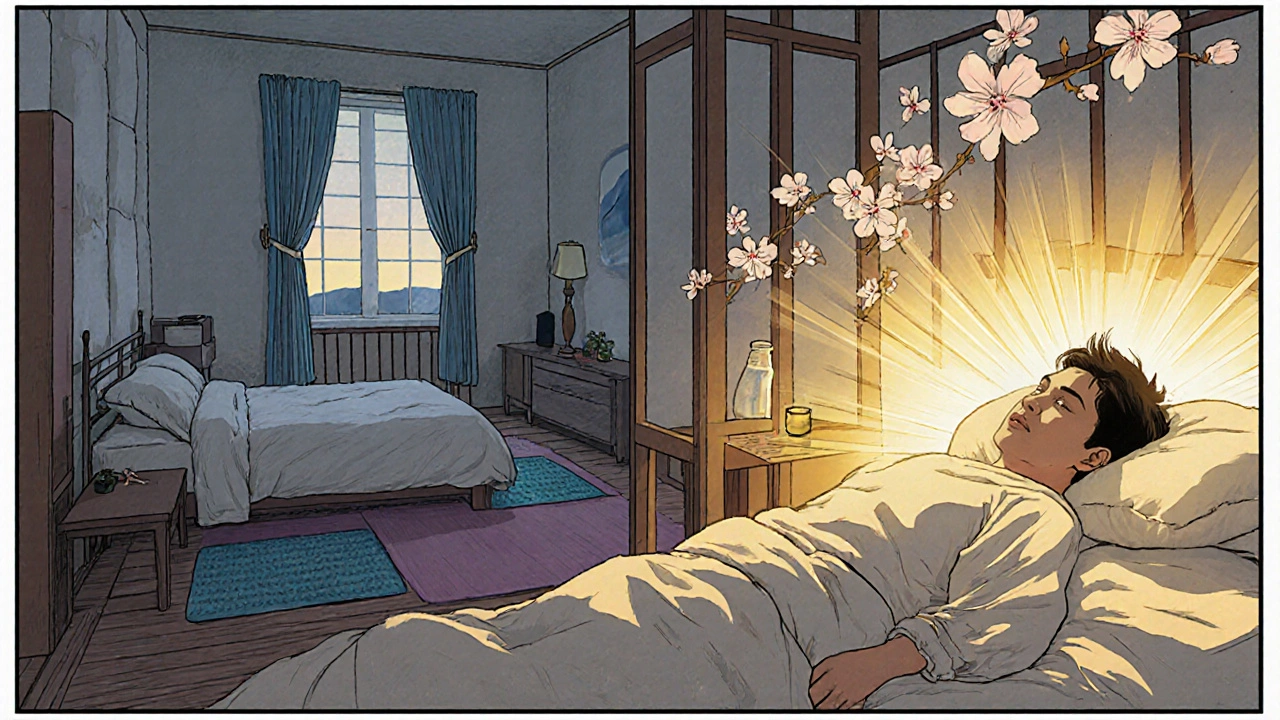
Le suivi neurologique : un diagnostic à long terme
Le RBD n’est pas seulement un trouble du sommeil. C’est un signe précoce de maladie du cerveau. L’Académie américaine de neurologie recommande un examen neurologique complet chaque année pour tout patient atteint de RBD idiopathique. Pourquoi ? Parce que la conversion vers une maladie neurodégénérative se produit à un taux de 6,3 % par an. Cela signifie qu’en 10 ans, plus de 60 % des patients développeront une maladie comme Parkinson ou la démence à corps de Lewy.
Ce suivi inclut l’évaluation des signes moteurs (lenteur, raideur, tremblement), des troubles de l’odorat, des changements de comportement, et parfois des examens d’imagerie cérébrale. Il ne s’agit pas de prédire l’avenir, mais de détecter tôt les premiers signes pour agir plus efficacement.
Quel avenir pour le RBD ?
Le marché mondial des traitements pour le RBD est estimé à 1,2 milliard de dollars en 2023, et devrait croître de 5,7 % par an jusqu’en 2030. Pourquoi ? Parce que les médecins reconnaissent de plus en plus ce trouble. Le nombre de diagnostics a augmenté de 217 % entre 2010 et 2020.
La recherche se tourne désormais vers un objectif plus ambitieux : non plus seulement calmer les rêves, mais ralentir ou empêcher la maladie du cerveau qui les suit. Des essais cliniques testent des molécules capables de protéger les neurones. Comme le dit le professeur Ronald Postuma, de l’Université McGill : « Les cinq prochaines années verront probablement les premiers traitements qui modifient la progression de la maladie chez les patients atteints de RBD. »
En attendant, la combinaison d’un traitement médicamenteux adapté, de mesures de sécurité rigoureuses, et d’un suivi neurologique régulier permet à la majorité des patients de vivre en sécurité - et de retrouver un sommeil paisible, pour eux et pour ceux qui les entourent.
Comment savoir si vous ou un proche êtes concerné ?
Voici les signaux d’alerte les plus courants :
- Vous ou votre partenaire avez des blessures inexpliquées (ecchymoses, coupures) après le sommeil.
- Vous vous réveillez en sueur, en état de confusion, après avoir fait des mouvements violents.
- Votre partenaire vous dit que vous criez, frappez, vous levez ou vous jetez hors du lit pendant la nuit.
- Vous vous souvenez de rêves violents (lutte, fuite, attaque) qui correspondent à vos mouvements.
- Vous avez déjà été diagnostiqué avec un trouble du mouvement ou une maladie neurologique.
Si vous reconnaissez l’un de ces signes, consultez un spécialiste du sommeil. Un simple test de polysomnographie peut changer la vie - et potentiellement la sauver.
Marcel Schreutelkamp
novembre 25, 2025 AT 09:45LAURENT FERRIER
novembre 25, 2025 AT 18:39Forrest Lapierre
novembre 27, 2025 AT 13:27Nathalie Rodriguez
novembre 28, 2025 AT 16:20Adèle Tanguy
novembre 29, 2025 AT 15:27Maurice Luna
novembre 30, 2025 AT 05:20Je connais des gens qui ont vécu ça, et je vous dis : prenez ça au sérieux, mais ne perdez pas espoir. La mélatonine, les tapis, les barrières - c'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Et oui, le clonazépam, c'est lourd, mais si ça vous permet de retrouver une nuit avec votre moitié, c’est une victoire. Vous êtes des guerriers du sommeil. Et bientôt, les nouveaux traitements vont changer la donne. On y est presque 💪🌙
manon bernard
novembre 30, 2025 AT 23:40Mathieu Le Du
décembre 2, 2025 AT 01:03